Quel Role pour la cour des comptes du budget de l'etat
Quel Role pour la cour des comptes du budget de l'etat
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
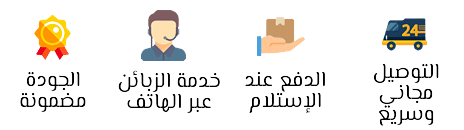
تفصيل
Deuxième édition 2019 pour l’auteur Jilali Amazid « LA RESPONSABILISATION DES ORDONNATEURS DU BUDGET DE L’ETAT » Quel rôle pour la cour des comptes ?
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
- Les ordonnateurs du budget de l’état : dépositaires d’une autorité budgétaire et financière
- Les ordonnateurs du budget de l’état : acteurs d’une fonction managériale
PREMIERE PARTIE :La responsabilisation des ordonnateurs :un processus au centre de la réforme des finances de l’Etat
TITRE I : Les instruments juridiques de la responsabilisation
- 1 : La refonte du régime juridique de la responsabilité financière
Section I : La loi n°61-99, entre délimitation et dilution des charges de responsabilité
Paragraphe I : La délimitation des charges de responsabilité
- La répartition des charges de responsabilité
- La portée personnelle et pécuniaire
Paragraphe II :Le risque de dilution des charges de responsabilité
- Le transfert des charges de responsabilité
- La décharge de responsabilité et la remise gracieuse
Section II : Les « cavaliers budgétaires » apport et désaccord
Paragraphe I : L’apport des modifications introduites par les lois de finances
- Les modifications intéressant la loi n°61/99
- Les modifications apportées au CJF
Paragraphe II : Le désaccord suscité par les modifications introduites par les lois de finances
- En ce qui concerne la forme
- En ce qui concerne le fond
Chapitre II : La réorganisation da la chaine d’exécution des dépenses
Section I : La Dématérialisation et le regroupement des contrôles a priori
Paragraphe I : La mise en place du système GID
- L’évolution des conditions de l’exécution des dépenses
- L’évolution des conditions d’intervention de la Cour des comptes
Paragraphe II : Le regroupement des contrôles a priori
- Sur le plan organique
- Sur le plan fonctionnel
Section II : L’introduction du contrôle modulé des dépenses
Paragraphe I : Le transfert des contrôles des dépenses vers les services ordonnateurs
- L’étendue des allégements de contrôle
- Les limites de la notion de « contrôle interne »
Paragraphe II – L’audit de la capacité de gestion
- Les organes habilités à réaliser des missions d’audit
- Le référentiel d’audit
TITRE II : Les instruments managériaux de la responsabilisation
CHAPITRE I : Le recentrage du débat budgétaire sur les résultats
Section I : La globalisation des crédits, un nouvel instrument de régulation budgétaire
Paragraphe I : L’assouplissement des conditions liées à la spécialité des crédits
- L’évolution des modes de contrôle sur les virements de crédit
- Les prérequis afférents à la capacité de gestion
Paragraphe II : les risques menaçant la finalité managériale de la globalisation des crédits
- L’absence de convergence des programmes
- L’incertitude de la mesure des résultats
Section II : La contractualisation :un levier de déconcentration budgétaire responsabilité
Paragraphe I :Les engagements des gestionnaires des services déconcentrés
- Les engagements portant sur l’affectation des moyens
- Les engagements afférents au respect de la subsidiarité
CHAPITR II : Le partenariat entre l’ordonnateur et le comptable public
Section I : Le rôle des services ordonnateurs dans la fonction comptable
Paragraphe I : Les opérations comptables effectuées au cours de l’exercice
- Les opérations en comptabilité administrative
- Les opérations en comptabilité générale
Paragraphe II : Les opérations comptables effectuées en fin d’exercice
- Le suivi des immobilisations et des créances
- Les nouvelles restitutions comptables
Section II :Le rôle du comptable public dans le débat de gestion
Paragraphe I : La contribution public dans le débat de gestion
- Le référentiel comptable interne
- Le guide interne de procédures
Paragraphe II :Le suivi de la qualité de l’exécution des dépenses
- La centralisation de la démarche au niveau du MEF
- La relégation de la fonction d’assistance
Conclusion de la première partie
DEUXIEME PARTIE : Le rôle de la cour des comptes dans la processus de la responsabilisation des ordonnateurs
TITRE I :La responsabilisation des ordonnateurs à travers le contrôle de la gestion
CHAPITRE I : Le contrôle de la gestion lié à la vérification intégrée des comptes
Section I : Le principe et la procédure du contrôle intégré
Paragraphe I : Le principe du contrôle intégré
- Les origines du principe
- La consécration du principe par le législateur marocain
Paragraphe II : La procédure d’instruction en mode intégré
- Une procédure écrite et contradictoire
- Les habilitations du conseiller rapporteur
Section II : Les difficultés de mise en œuvre du contrôle intégré
Paragraphe I : L’ambigüité de la notion de « service de L’Etat »
- Au niveau du jugement des comptes
- Au niveau du contrôle de la gestion
Paragraphe II : La présentation réductrice du compte de gestion
- Le manque des données sur la gestion de l’ordonnateur
- L’insensibilité de la présentation du compte de gestion au partage des responsabilités
- L’absence de la dimension patrimoniale dans le compte de gestion
CHAPITRE II : Le contrôle de la gestion issu de la programmation discrétionnaire
Section I : Une portée en pleine expansion
Paragraphe I : L’approche par organisme et par projets publics
- Le contrôle de la gestion des organismes
- L’évaluation des projets publics : cas du programme Manarat Al Moutaouassit
Paragraphe II : L’approche par thèmes
- L’évaluation thématique :un nouveau mode d’intervention ?
- L’évaluation thématique :une variante du contrôle de la gestion ?
Section II : Le positionnement du contrôle de la gestion par rapport à la réforme des finances de l’Etat
Paragraphe I : Le degré d’accompagnement des chantiers de la réforme
- Place réduite des services de l’Etat dans la programmation des missions
- Faible intérêt accordé à la problématique managérial
Paragraphe II : L’impact du contrôle de la gestion en termes de perfectionnement
- L’articulation entre contrôle de la gestion et règlement du budget de l’Etat
- Les suites réservées aux recommandations
TITRE II : La responsabilisation des ordonnateurs à travers la discipline budgétaire et financière
CHAPITRE I : La mise en œuvre de la de la responsabilité financière des ordonnateurs :Limites et risques
Section I :Les limites résultant de l’immunité juridictionnelle des ordonnateurs principaux
Paragraphe I : La déresponsabilisation induite par les modes d’institution des ordonnateurs
- L’institution d’office des ordonnateurs principaux
- La désignation des ordonnateurs secondaires
- L’institution des ordonnateurs par délégation de signature
Paragraphe II : La déresponsabilisation liée aux ordres de régulation budgétaire
- Le passer outre au refus de visa
- L’ordre écrit
- La réquisition de paiement
Section II : Les risques inhérents à la saisine interne
Paragraphe I : Le risque de partialité institutionnelle
Paragraphe II : Le risque de confusion entre contrôle de la gestion et incrimination des gestionnaires
- Les effets négatifs de la confusion sur l’instruction
- Les effets négatifs da la confusion sur les rapports du contrôle de la gestion
CHAPITRE II : L’évolution de la jurisprudence vers la rationalité managériale : contraintes et perspectives
Section I : Les contraintes liées à la prédominance de la régularité
Paragraphe I : Les infractions rattachables à l’irrégularité de l’engagement de dépense
- L’engagement de dépenses en tant que création d’obligation
- L’engagement de dépense en tant que constatation d’obligation
Paragraphe II : Les infractions rattachable à l’irrégularité de la liquidation et d’ordonnancement des dépenses
Section II : La désuétude des dispositifs régissant la responsabilité à raison des résultats négatifs de la gestion
Paragraphe I : La faute de gestion :une notion volatile
Paragraphe II : La condamnation au remboursement :une mesure inopérante
- Une nature juridique hybride
- Une mise en œuvre improbable
Section III : Les perspectives incertains d’une jurisprudentielle favorable à la rationalité managériale
Paragraphe I : L’effet inconsistant de la prise en compte des circonstances atténuantes
Paragraphe II : L’attitude jurisprudentielle controversée concernant le raisonnement par obligation des résultats
- L’arrêt de la cour des comptes n° 01/2014 DBF du 3 juillet 2014
- L’arrêt de la cour de cassation n° 1/952 juin 2017
Conclusion de la deuxième partie
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
Liste des encadrés
- الرقم الدولي: 9789920371247
- السلسلة:
- التصينف: القانون العام
- نوع الكتاب: كتاب
- الطبعة: 2019
- الثمن: 100,00 د.م
- الحجم: 17 x 24
- عدد الصفحات: 320









